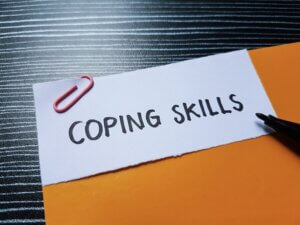Coping : faire face au stress
Coping : des stratégies efficaces pour faire face au stress dans le sport, le travail et la vie quotidienne
Le terme « coping » vient de l’anglais to cope, signifiant « faire face ». Il désigne les stratégies cognitives, émotionnelles et comportementales qu’un individu met en œuvre pour s’adapter à une situation perçue comme stressante ou menaçante pour son bien-être physique ou psychique.
A travers cet article, je vais aborder quelques éléments théoriques (forcément réducteur car le sujet est vaste). Je montrerai différentes stratégies de coping dans le monde du sport, du travail ou de la vie quotidienne.
Qu’est-ce que le coping ? Définitions
Dans leur ouvrage de référence « Stress, Appraisal and Coping » (1984), Lazarus & Folkman définissent le coping comme :
« un ensemble d’efforts cognitifs et comportementaux en constante évolution déployés pour gérer des demandes internes et externes perçues comme dépassant les ressources de la personne. »
A travers cette définition un peu complexe, on comprend qu’il existe entre guillemets 2 composantes dans le stress :
- un aspect réactionnel hormonal automatique. Avec notamment, l’hypothalamus qui active le système nerveux autonome sympathique qui stimule des glandes surrénales. Ces dernières déclenchent alors la sécrétion d’adrénaline (80%) et de noradrénaline (20%) qui permettent de mobiliser rapidement glucose et oxygène. Après cette phase d’alarme vient la phase de résistance avec la libération du cortisol.
- un mécanisme d’évaluation cognitive de la situation. Face à ce qui se vit à cet instant, notre cerveau pratique une analyse rapide entre sa perception de la situation et la perception de nos capacités pour y faire face. Il établit ainsi une forme de balance entre un stress adapté ou inadapté.
Le modèle fondateur de Lazarus & Folkman (1984)
Le coping est donc un processus transactionnel. C’est à dire des actions réciproques entre le sujet et l’environnement.
- Evaluation de la situation : est ce une menace, un défi, une perte ?
- Evaluation de mes ressources disponibles : puis-je agir ? suis-je capable ? comment ?
C’est une démarche interactive, évolutive, spécifique.
En effet, nous sommes toujours en train d’analyser la situation, nos ressources pour y faire face pour nous adapter.
De plus, nous ne percevons pas tous la même situation de la même manière. Les facteurs environnementaux, situationnels, personnels comme les traits de personnalité, les croyances, les motivations, sont autant d’éléments différenciants.
Lazarus & Folkman identifient deux grandes fonctions du coping, souvent appelées axes fonctionnels :
- Stratégie centrée sur le problème : efforts dirigés vers l’environnement pour agir sur la situation stressante.
- Stratégie centrée sur les émotions : efforts pour réguler la réponse émotionnelle à la situation.
L’élargissement par Endler & Parker (1990) : le modèle du CISS
Le Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) développé par Endler & Parker distingue trois styles stables de coping, mesurables :
- Coping orienté vers la tâche (task-oriented coping) : résolution de problème, planification, efforts pour modifier la source de stress.
- Coping orienté vers les émotions (emotion-oriented coping) : expression des émotions, régulation émotionnelle.
- Coping orienté vers l’évitement (avoidance-oriented coping) : distraction cognitive ou comportementale (faire autre chose) ou diversion sociale (chercher la compagnie d’autres pour oublier le stress) ou la consommation (manger, drogues, jeux, etc.)
C’est un questionnaire de 48 items répartis sur les 3 fonctions.
Auparavant, l’évitement n’était pas identifié comme une catégorie à part entière. Il était vu comme une stratégie émotionnelle de régulation. Cette typologie a l’avantage de faire du coping d’évitement une catégorie autonome, objectivée par des études statistiques (analyses factorielles). C’est elle qui est souvent utilisée dans les contextes sportifs et professionnels actuels.
Il est à noter que sous certaines formes, les stratégies d’évitement peuvent être parfaitement délétères. D’autres peuvent soulager temporairement, mais être inefficaces à long terme et corrélées à davantage de stress, de fatigue mentale, voire de désengagement.
Les 4 grandes catégories de coping
Le coping est une approche flexible et consciente pour faire face à la réalité. Cela demande « un effort ». On ne fait pas du coping « par hasard ». C’est par exemple, un point de différence avec les mécanismes de défense que nous activons aussi dans certains cas.
Le coping centré sur le problème (ou coping orienté tâche)
Ce type de coping consiste à agir sur la situation stressante elle-même pour la résoudre, l’atténuer ou la rendre plus prévisible. Mais également à augmenter ses propres ressources pour y faire face. Cela suppose que l’on puisse avoir un certain niveau de contrôle ou d’action sur la situation.
Par exemple :
- Dans le cadre d’un projet ou la pression est forte, la cheffe de projet échange avec son équipe et son client. Elle propose une restructuration de l’équipe et du planning avec de nouvelles personnes, une nouvelle organisation avec une décomposition et des priorités ajustées.
- Un manager de business unit en totale surcharge qui met en place plusieurs actions : identification des sujets urgents et importants en lien avec ses responsabilités, délégation de tâches, réorganisation de l’équipe.
- Une judokate lors d’un combat en championnat du monde se rend compte de son inefficacité au bout d’une minute 30. Sur une pause, elle écoute les consignes de son coach, prends le temps (quelques secondes) de choisir une autre stratégie. Sur la reprise suivante, elle change la position de ses mains et décide de lancer une attaque dans une direction et un sens qu’elle n’avait pas encore réalisé dans ce combat. Elle marque waza-ari.
Il est intéressant de noter que cette approche est souvent modulable et proactive.
Coping centré sur les émotions
Il s’agit ici de moduler les émotions générées par la situation (par exemple, tristesse, colère, peur.) Cette stratégie ne change pas la situation, mais aide à restaurer un équilibre intérieur. Elle est particulièrement utile quand la situation est peu ou pas contrôlable.
Quand une cavalière participe à son premier concours international, forcément cette situation a des enjeux pour elle. La pensée magique « c’est un concours comme un autre » (coping d’évitement) a fort peu de chance de fonctionner. Accepter la situation (avec les émotions), les réguler et lâcher prise ont été des facettes de la démarche d’accompagnement en préparation mentale que nous avons réalisée ensemble. Concrètement, nous avons travaillé des aspects de journaling (écrire les choses), de respirations (cohérence cardiaque, respirations profondes, respirations tension relâchement), la construction de routine pré compétition et dans les temps faibles de la compétition (en concours complet, il y a 3 épreuves très distinctes qui se déroulent sur 2 jours), de marche en conscience de ses parcours lors de la reconnaissance.
Coping d’évitement (ou désengagé)
Cette stratégie vise à fuir la réalité stressante, à la contourner ou à se dissocier émotionnellement de la situation. Elle peut inclure le déni, la distraction, la fuite physique ou psychologique. Elle est souvent utilisée quand la personne se sent impuissante ou dépassée.
A court terme, cela peut réduire l’intensité du stress. Mais à long terme, c’est souvent contre-productif si aucun travail sur soi n’est fait, car cela retarde l’action et entretient le mal-être. L’intention du coping d’évitement me semble fondamental pour qualifier son efficacité ou son inefficacité.
Un manager n’aime pas les conflits et fuit systématiquement dès que les situations deviennent tendues. Stratégie d’évitement efficace à court terme peut être mais qui n’est pas adaptée sur un temps long. Il demande à être accompagné en coaching pour travailler ce sujet en particulier. Maintenant en conscience, il y a certaines situations qu’il laisse passer et d’autres qu’il gère.
D’autres exemples concrets de stratégie d’évitement :
- Distraction comportementale : Jouer à un jeu vidéo pour ne pas penser au stress, se lancer dans une tâche secondaire au détriment d’une tâche importante
- Distraction cognitive : scroll sur les réseaux sociaux sans but
- Diversion sociale : sortir pour oublier ses soucis (et sans en parler, échanger, verbaliser)
- Consommation : manger sans faim, alcool, achats impulsifs
Une étude de Carver et al. « Cope Inventory » (1989) identifie les stratégies de déni, de désengagement mental ou comportemental (par exemple le repli sur soi), et d’usage de substances comme formes de coping dysfonctionnelles.
Le coping centré sur le soutien social
Cette approche consiste à solliciter en conscience de l’aide, du réconfort ou des conseils auprès de son entourage : amis, famille, collègues, professionnels. Elle peut être émotionnelle (partager ses émotions) ou opérationnelle (par exemple, obtenir une aide concrète).
Par exemple pour les athlètes, le fait de pouvoir échanger avec l’entraineur, les coéquipiers, le coach mental, un(e) psychologue pour parler des problèmes rencontrés, relâcher la pression.
Ce type de coping est transversal : il peut soutenir un coping centré problème (en demandant des ressources) ou émotion (en exprimant un mal-être).
Souvent en entreprise, cette forme de coping est un révélateur puissant de la capacité d’une organisation à libérer la parole et accepter l’échec. En effet, un salarié pourra avoir du mal à demander de l’aide s’il a peur d’être jugé, ou si on ne lui apporte aucune solution concrète.
Qu’est ce qu’un coping efficace ? et inefficace ?
Un des points importants à prendre en compte est le niveau de contrôle que l’on peut avoir sur une situation. Lors du Covid et du confinement certaines personnes ont eu le sentiment d’être obligé de subir cette situation anxiogène. Ce sentiment de perte de contrôle a des effets négatifs impactant notre rythme circadien de sommeil, notre système immunitaire, nos relations interpersonnelles et notre santé mentale. Comme je l’ai expliqué plus haut, le coping offre plusieurs stratégies d’adaptation en fonction de la situation.
Il me semble important de préciser qu’une stratégie de coping est efficace (ou adéquate) si elle permet à une personne de maîtriser la situation stressante et / ou de réduire les impacts sur son bien-être physique et psychique. Il est donc tout à fait possible de combiner plusieurs catégories de coping.
Un autre facteur me semble important à prendre en considération : notre parcours de vie respectif qui notamment peut jouer sur nos perceptions de la menace et donc des réponses à y apporter. Rien n’est irrémédiable sur ce point ! Toutes les approches favorisant une meilleure connaissance de soi permettent de prendre conscience et de travailler cet aspect.
Critères d’un coping efficace : l’adaptation contextuelle
Un coping efficace est une stratégie d’adaptation qui permet à la personne :
- de réduire ou réguler son stress perçu,
- de préserver ou améliorer son fonctionnement (santé mentale, relations, performance),
- de maintenir un sentiment de contrôle et de compétence personnelle.
Ce qui est efficace dans une situation donnée peut devenir inefficace dans une autre. La clé repose donc sur l’ajustement de la stratégie au type de stress rencontré :
- Si la situation est contrôlable, le coping orienté vers la tâche est souvent le plus pertinent
- Si elle est hors de contrôle (ex. : accident, pandémie, échec déjà survenu), un coping centré sur la tâche est inefficace voir nocif pour la santé (cf. Lazarus et Folkman, 1984). Un coping émotionnel est plus adapté s’il est couplé avec un travail d’acceptation et de lâcher prise (de nombreuses études vont dans ce sens).
Modèle intégré de Lucie Côté
Le modèle développé par Lucie Côté (2013) articule coping et contrôlabilité perçue de la situation. Tout en intégrant également les aspects bien être et stratégie d’évitement.
Si une situation est maîtrisable et que la personne agit = Coping efficace
Par ses actions, elle contribue à une modification de la situation et des impacts sur elle. On peut avoir des actions centrées sur la tâche, sur le fait de rechercher des informations pertinentes, de développer ses connaissances. Mais aussi sur des aspects de communication, de régulation émotionnelle, d’organisation du temps. Et également du soutien en demandant de l’aide, des conseils. Donc diverses formes de coping.
La situation est maîtrisable et la personne n’agit pas = Coping inefficace
La personne subit la situation. Elle est dans une forme de résignation, voir d’apitoiement sur ce qu’elle vit. En entreprise, cela peut prendre une forme de déresponsabilisation, laisser les problèmes se résoudre tout seul (ou par les autres), procrastiner.
La situation est non contrôlable et la personne tente d’agir dessus = Coping inefficace
Dans ce cadre, les actions ne servent à rien. C’est une forme d’acharnement qui génère beaucoup de frustration et d’anxiété. Un profond sentiment d’impuissance. Et au final d’épuisement. Cela peut être encore renforcé pour les personnes « perfectionniste » (le « sois parfait » de l’analyse transactionnelle) qui pensent ne pas en faire assez.
Si la situation est non contrôlable et que la personne lâche prise = Coping efficace
La stratégie de lâcher prise ne veut pas dire que l’on est OK avec la situation. C’est le fait de composer avec la réalité et d’agir (ou de ne rien faire) en conséquence. Cela peut être de revoir ses objectifs, d’accepter les limites. Mais aussi de prendre en considération ses émotions, sa frustration et de les réguler, en faire quelque chose au service de son projet. C’est également de se concentrer sur les points maîtrisables, ceux qui m’appartiennent.
Cette situation est très fréquente dans le milieu du sport et en particulier les compétitions, les matchs, les concours où la plupart du temps « cela ne se passe pas comme prévu ! ».
Bien-être et stratégie d’évitement
Ce que montre Lucie Côté à travers ses diverses études, c’est que toutes les stratégies de bien-être sont adaptées et positives. Quand on parle de bien-être, c’est sous ses formes les plus larges : relations interpersonnelles positives, engagements dans la vie social / personnelle, activités physiques adaptées, sommeil, le plein air, une alimentation saine.
A l’inverse, les stratégies d’évitement ont une efficacité restreinte à un laps de temps court. Elles deviennent rapidement inefficaces et inadaptées.
Quand le coping devient inefficace
Un coping est dit inefficace ou désadapté :
- quand il soulage à court terme mais empêche l’évolution ou la résolution du stress,
- s’il est rigide sans adaptation au contexte,
- quand il augmente la détresse psychologique (rumination, culpabilité, isolement),
- s’il est basé sur la fuite répétée des situations à enjeux sans traitement du stress afférant,
- s’il affaiblit les ressources personnelles (sommeil, concentration, confiance en soi),
- quand il crée de nouveaux problèmes (conflits, retard, désengagement).
💬 Si à ce stade, vous vous reconnaissez dans certaines réactions, il peut être utile de faire le point sur vos propres stratégies d’adaptation.
➡️ Me contacter pour un premier échange gratuit et sans engagement.
Les apports de Bandura : l’auto-efficacité et le pouvoir d’agir
Le psychologue canadien Albert Bandura a mis en lumière dans ses travaux, à partir de 1986, la notion d’auto-efficacité (notre efficacité personnelle). Elle a 4 sources :
- Les réussites passées (maîtrise directe) — ex. : « J’ai déjà traversé une crise similaire »
- L’observation de modèles (apprentissage vicariant) — ex. : « D’autres y sont arrivés »
- Le feedback de personnes reconnues — ex. : encouragements, reconnaissance
- La régulation émotionnelle — ex. : savoir retrouver son calme face à l’adversité
« Ce n’est pas seulement ce que l’on sait faire, mais ce que l’on croit pouvoir faire qui détermine notre action. ». Si une personne pense pouvoir produire des résultats, elle agira efficacement. Si cette dernière a une auto-efficacité forte, elle aura tendance à adopter des stratégies actives, flexibles et constructives. À l’inverse, un sentiment d’impuissance ou d’inefficacité favorise l’évitement, la déresponsabilisation ou la rumination.
Le coping dans le monde du sport et en entreprise
Dans ce chapitre, je partage des expériences de personnes que j’accompagne depuis 2012. Mais également des études qui ont réalisées sur ce sujet.
Gérer la pression et rebondir après un échec
Ces deux sujets sont systématiquement présents dans tous les accompagnements que je réalise. Tôt ou tard, ils apparaissent. Mon approche longitudinale se base sur la co-construction personnalisée de protocoles / solutions. Voici quelques exemples concrets :
- Utilisation du renforcement positif (Techniques d’Optimisation du Potentiel ®) en visualisation d’un trail passé réussi, un combat de judo gagné avec la manière, un parcours de cross maitrisé, un meeting sur 800 m … associée à des mots clefs positifs. Pour certains, nous avons utilisé aussi le switch (signe signal / ancrage) soit à travers un mot, soit à travers un geste adapté.
- Construction d’une réussite à venir, la prochaine compétition à travers le protocole de PMR (Préparation Mentale de la Réussite) et ses fameux What if. Contrairement à ce que j’ai entendu de la part d’un entraineur, on ne vend pas du rêve dans cette démarche ! C’est l’athlète qui construit sa victoire en prenant en compte les aléas, y compris ceux qu’il ne peut prévoir.
- Travail de la flexibilité attentionnelle pour une meilleur concentration et laisser de côté les distracteurs. Particulièrement utile pour ne pas entendre le public ou des remarques au bord d’un terrain de foot, de tennis par exemple.
- Co construction de routines. Elles peuvent prendre plusieurs formes, avoir plusieurs temporalités. Par exemple, des routines pour la veille d’un championnat du monde de triathlon longue distance. Mais aussi des routines de matin de course, une Dynamisation Psycho-Physiologique à quelques minutes d’une descente de kayak ou d’un biathlon.
- Espace de paroles proposé aux athlètes avant / après chaque compétition. Debriefing systématique des courses, des compétitions pour tirer des apprentissages. Travail d’acceptation (deuil) de ce qui s’est passé. Adaptations et changements sur les courses à venir.
De nombreuses études ont été réalisées sur ce sujet dans le domaine du sport. Quelques exemples :
- Gould, Eklund & Jackson (1993) sur des champions de patinage artistique américains
- Poczwardowski & Conroy (2002) sur 16 athlètes et artistes
- Barbara Nuetzel, Revue systématique portant sur 21 études publiées entre 2010 et 2023 sur des athlètes d’élite (internationaux, olympiques, professionnels)
Faire face à un stress quasi permanent
Il me semble que l’un des changements notables dans les organisations, est que le stress perçu est devenu quasi permanent. Il y a quelques années, on connaissait des moments de pression forte, contrebalancés par des temps plus calmes. Aujourd’hui, l’immédiateté, la réactivité, une forme de temporalité raccourcie font que le stress est presque toujours présent. Je constate que souvent les facteurs de stress, de questionnement sont liés à :
- une charge de travail excessive ou un déficit d’organisation,
- des rôles et responsabilités peu clairs
- un manque de reconnaissance ou d’autonomie,
- des relations hiérarchiques ou interpersonnelles tendues.
L’INRS (l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) a mené de nombreuses études sur le stress, sur les risques psychosociaux (RPS). Elle a évalué les apports du coping. Et notamment des outils comme le CISS et le WCC (Ways of Coping Checklist). Non seulement à titre individuel mais aussi au niveau collectif et organisationnel. Cela permet la mise en place de plan d’actions RH et managériaux adaptés.
Dans mes accompagnements en coaching professionnel, j’interviens souvent sur :
- identifier ses mécanismes automatiques de réaction au stress,
- explorer d’autres stratégies, plus adaptées aux objectifs de performance ou d’équilibre,
- clarifier l’organisation, les rôles (par exemple, mise en place d’un RACI)
- tester des actions concrètes et en observer les effets.
Conclusion : être acteur de son adaptation
Le stress n’est pas seulement une réaction chimique liée à une situation. C’est une interaction entre notre perception, notre vécu, nos croyances, et notre capacité à choisir une réponse adaptée.
Dans ce cadre, le coping n’est ni une recette miracle ni un simple réflexe. C’est un processus conscient, mobilisable et ajustable, qui nous rend à nouveau acteurs de notre adaptation — face à la pression d’un résultat, à une surcharge chronique, à une transition professionnelle, ou tout simplement à la réalité de la vie.
Pour moi, la puissance du coping tient au fait qu’il mobilise nos dimensions mentales, émotionnelles, relationnelles. C’est donc un levier puissant pour faire face, pour développer sa résilience, progresser une performance écologique pour soi. Ou simplement vivre plus en accord avec soi-même.